Vieillir au cœur des métropoles ne va pas de soi, même là où les services, les transports et les activités semblent tout offrir. Ce numéro interroge les ambivalences du vieillissement urbain : entre proximité et isolement, confort et contraintes, injonctions écologiques et réalités sociales. Il propose de penser la ville comme un espace traversé par de multiples tensions, où les parcours de vie des personnes âgées révèlent les limites d’une urbanité supposée inclusive.
Comment vieillir au cœur de métropoles fragmentées ?
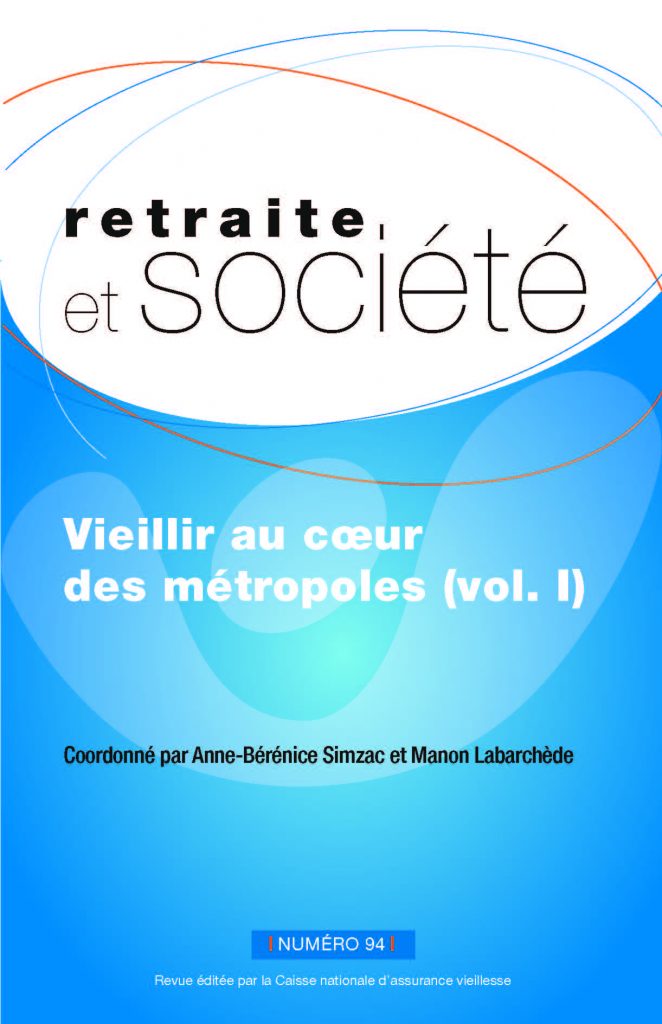
Vieillir au cœur des métropoles, là où tout paraît à portée de main — services, transports, loisirs —, s’avère bien moins aisé qu’on ne le croit. Des inégalités sociales et spatiales traversent ces environnements urbains. Elles influencent fortement les conditions de vie des personnes âgées. L’attachement au quartier et au logement peut renforcer le sentiment de sécurité. Cependant, il ne suffit pas toujours à garantir une vie sociale active et heureuse.
Selon les contextes, la ville peut donc soutenir ou fragiliser les parcours de vieillissement. Ces disparités questionnent les formes d’habiter, les ressources et les liens de proximité dans un tissu urbain en constante évolution.
Habiter des grandes villes en mutation
Dans ce paysage urbain contrasté, les enjeux écologiques viennent aussi redessiner les pratiques et les gestes quotidiens des retraités. La transition environnementale, conjuguée au vieillissement démographique, transforme les manières d’habiter la ville. Les seniors adoptent des écogestes (tri, maîtrise énergétique, mobilité douce) souvent guidés par des logiques de confort ou d’économie. Si ces pratiques peuvent créer du lien social, elles mettent aussi en évidence les limites de l’appropriation des politiques écologiques trop souvent conçues sans les habitants. Elles rappellent que les villes ne seront pas durables sans être inclusives.
Vieillir en ville, est-ce y rester vraiment ?
Vieillir en ville, c’est aussi composer avec les mobilités et l’accès aux espaces du quotidien — des enjeux cruciaux souvent négligés. Les commerces, les espaces de rencontre et les services de proximité contribuent fortement à préserver les relations sociales. Pourtant, les transformations urbaines, les logiques d’aménagement et les évolutions générationnelles peuvent créer des distances, physiques ou symboliques, entre les personnes âgées et leur environnement. Certaines populations se trouvent reléguées hors des centres-villes, tandis que d’autres restent sur place mais voient leur quartier se transformer jusqu’à y perdre leurs repères. Ces dynamiques soulèvent la question de l’habitabilité urbaine et de la capacité des métropoles à accueillir durablement les trajectoires de vie des plus âgés.
Ce numéro propose une plongée dans la ville telle qu’elle se vit — fragmentée, ambivalente, parfois hostile — et telle qu’elle pourrait être : un territoire de liens, d’usages réinventés et d’inclusion pour tous les âges.
Coordinatrices, autrices, auteurs
Ont coordonné ce numéro : Anne-Bérénice Simzac, sociologue, responsable du pôle recherche de Generacio et chercheuse associée au LHAC, ENSA Nancy & Manon Labarchède, architecte et postdoctorante en sociologie (projet ANR COMPAC), laboratoire Passages, UMR CNRS 5319
Ont participé à ce numéro : Jimmy Armoogum, Simon Davies, Anne-Valérie Demenus, Beatriz Fernandez, Christophe Humbert, Élodie Llobet, Isabelle Mallon, Joël Meissonnier, Julie Pélata, Mélissa-Asli Petit, Damien Rondepierre.
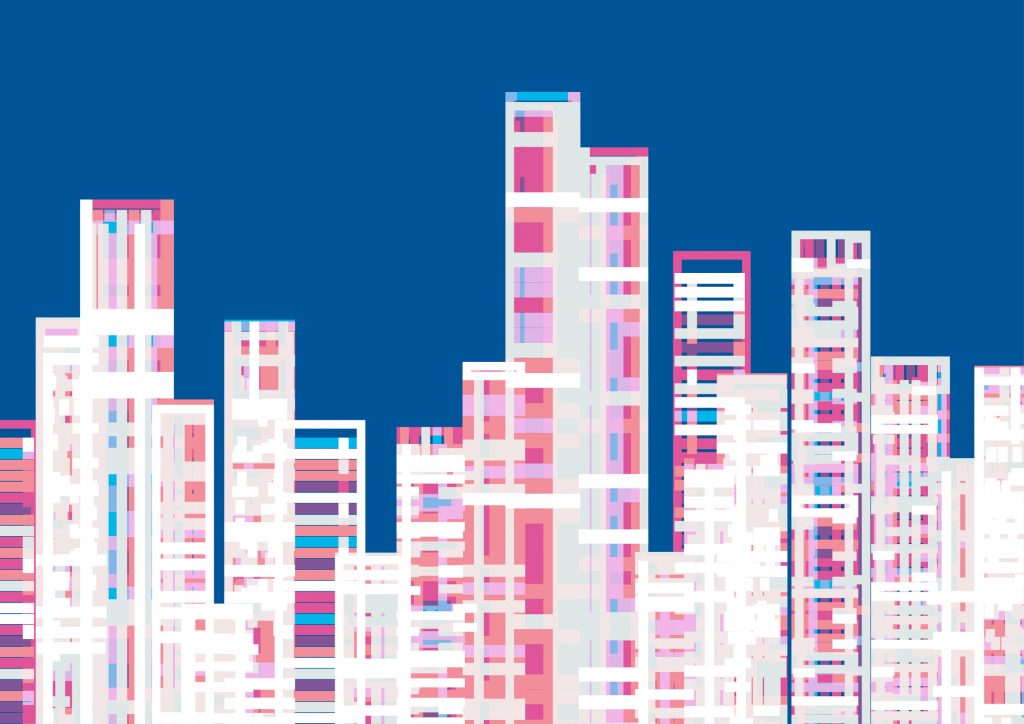
Pour télécharger les articles, rendez-vous sur Cairn.
Découvrir la revue sur notre site.
Commander ce numéro en version print : retraiteetsociete@cnav.fr






